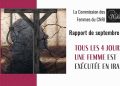La résistance des prisonnières politiques inspire les femmes et les filles iraniennes dans leur lutte contre le régime des exécutions et des massacres
Rapport de octobre 2025 : Avec l’exécution sans précédent de près de 300 prisonniers en Iran, octobre 2025 restera le mois le plus sanglant des 36 dernières années du pays. Parmi les victimes figuraient au moins sept femmes, ce qui en fait l’un des chiffres mensuels les plus élevés d’exécutions féminines depuis les années 1980.
Cette vague d’exécutions montre la peur et le désespoir d’un régime acculé par de multiples crises politiques et économiques, incapable d’apporter la moindre réponse au mécontentement croissant de la population, et cherchant seulement à retarder un soulèvement inévitable menaçant sa chute.
Dans ce contexte, à la fin du mois d’octobre, le régime clérical a franchi une nouvelle étape en prononçant une peine de mort contre une prisonnière politique, Zahra Shahbaz Tabari, soutien de l’Organisation des Moudjahidines du Peuple d’Iran (OMPI/MEK).
Pour le régime, l’exécution est un instrument de survie. Une autre méthode insidieuse d’élimination des prisonniers consiste à les priver délibérément de soins médicaux dans des prisons dépourvues des conditions d’hygiène et de santé les plus élémentaires, bien en deçà des normes internationales.
Fin septembre, au moins trois prisonnières, dont Somayeh Rashidi à la prison de Qarchak, ainsi qu’une autre détenue à Fardis, ont perdu la vie à la suite de soins médicaux différés.
En parallèle à cette répression, la résistance des prisonniers a atteint en octobre un niveau inédit : sit-in et protestations dénonçant les morts en détention, grève de la faim de 1 500 condamnés à mort à Ghezel Hessar, campagne “Les Mardis contre les exécutions”, et manifestations des familles de prisonniers condamnés à mort. Tous ces actes de défi ont marqué une nouvelle phase de mobilisation et obtenu des résultats significatifs.
Zahra Shahbaz Tabari, prisonnière politique, condamnée à mort
Le 25 octobre, des sources ont rapporté que Zahra Shahbaz Tabari, 67 ans, avait été condamnée à mort par la 1ʳᵉ chambre du tribunal révolutionnaire de Rasht pour soutien à l’Organisation des Moudjahidines du peuple iranienOMPI/MEK.

Zahra Shahbaz Tabari
C’est la première fois qu’une femme sympathisante de l’OMPI reçoit une telle condamnation, un signal de terreur adressé par le régime aux femmes iraniennes, en première ligne des manifestations et de la contestation, afin de les dissuader de rejoindre l’opposition organisée.
Selon sa famille, l’audience s’est tenue en ligne, a duré moins de dix minutes, et l’avocat commis d’office n’a présenté aucune défense effective. La condamnation a été prononcée immédiatement.
Les soi-disant “preuves” à charge se limitaient à un morceau de tissu portant le slogan “Femme, Résistance, Liberté” et à un message audio non publié, que sa famille a dénoncé comme fabriqué de toutes pièces.
Mme Zahra Shahbaz Tabari est titulaire d’un master en génie électrique, diplômée de l’Université de technologie d’Ispahan et de l’Université de Borås en Suède, spécialisée en énergie durable.
Elle a été arrêtée le 17 avril 2025, lorsque des agents de sécurité ont pris d’assaut son domicile sans mandat, et elle est actuellement détenue à la prison de Lakan à Rasht.
La Commission des Femmes du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI) appelle les organes compétents des Nations unies et toutes les organisations internationales de défense des droits humains à agir immédiatement pour sauver la vie de Zahra Shahbaz Tabari et celle des autres prisonnières politiques condamnées à mort.
Condamnations arbitraires et incertitude juridique pour les prisonnières politiques
Il convient de noter que Fariba Khorram-Abadi, professeure de théologie, mère d’un enfant, arrêtée en août 2025 sans mandat, a été informée le 23 octobre qu’elle avait été condamnée à un an et demi de prison pour “propagande contre le régime” et “appartenance à des réseaux antigouvernementaux”.
Souffrant d’antécédents cardiaques, elle est détenue dans des conditions alarmantes à la prison de Fardis (Karaj). Après avoir reçu un mauvais traitement médicamenteux, elle a développé de graves tremblements neurologiques et des crises répétées.
Malgré son état critique, les gardiens lui ont enchaîné les mains et les pieds pour la transférer à l’hôpital, une humiliation qui a aggravé sa souffrance. En signe de protestation, elle a refusé d’être hospitalisée.
Manijeh Hassani-Fard, 62 ans, mère de deux enfants, est détenue à Fardis depuis août 2025, également sans mandat ni inculpation.

De gauche à droite : Fariba Khorram-Abadi, Manijeh Hassani-Fard et Yalda Emamdoust
Aucune autorité judiciaire ou sécuritaire n’a reconnu sa responsabilité dans cette arrestation, et aucune information n’a été fournie sur les raisons de sa détention ni sur son état de santé.
De même, Yalda Emamdoust, 50 ans, sportive et mère de deux enfants, a été arrêtée à la mi-août sans mandat et transférée vers un lieu inconnu.
Aucune information n’a émergé sur son lieu de détention ni sur son état, et aucune autorité judiciaire ou sécuritaire n’a reconnu sa détention.
Femmes exécutées en octobre
- Zeinab Khodabandeh – 13 octobre
- Nahid Hemmati – 15 octobre
- Kafieh Ghabadzadeh – 15 octobre
- Saeedeh Khodadadi – 22 octobre
- Narges Ahmadi – 25 octobre
- Mahboubeh Jalali – 25 octobre
- Katayoun Shamsi – 29 octobre
L’examen de ces cas, après des procès iniques et sans défense légale, révèle que la plupart de ces femmes étaient victimes de la pauvreté ou des lois familiales discriminatoires. Beaucoup avaient tué leurs maris violents en légitime défense.
La prisonnière politique Golrokh Ebrahimi Iraee, dans une lettre datée du 27 juillet 2019, après avoir étudié les cas de femmes condamnées à mort pour meurtre, écrivait :
« La majorité d’entre elles avaient tué leurs maris après des années de violences conjugales — insultes, coups, parfois tortures — parce qu’elles n’avaient pas le droit au divorce. Si les juges avaient accepté leurs demandes répétées de séparation, elles n’auraient jamais commis de tels actes désespérés. »
Résistance contre les exécutions : de Ghezel Hessar aux rues de Téhéran
La recrudescence des exécutions n’a pas réduit les voix de la contestation ; au contraire, le cri « À bas les exécutions » résonne plus fort que jamais, des prisons jusqu’aux rues. Le mois d’octobre a vu un acte de défi sans précédent de la part des prisonniers condamnés à mort face à la machine de mort du régime.
Entre le 13 et le 19 octobre, 1 500 détenus du quartier 2 de la prison de Ghezel Hessar, à Karaj, ont entamé une grève de la faim pour protester contre la vague d’exécutions. Il s’agit de la plus vaste grève collective de l’histoire des prisons sous le régime des mollahs. Celle-ci n’a pris fin temporairement que lorsque les autorités ont été contraintes à un recul exceptionnel face à l’ampleur de la contestation à l’intérieur des prisons.
Cette grève de la faim, marquée par des lèvres cousues et des corps émaciés, a reçu un puissant écho de solidarité de la part des familles des prisonniers. Épouses, mères, sœurs et enfants se sont rassemblés à trois reprises devant la prison de Ghezel Hessar et devant le Parlement des mollahs à Téhéran, brisant le mur de la censure du régime et faisant entendre la voix des prisonniers au grand public, qui y a répondu par une large sympathie et un soutien croissant.
Ces rassemblements et manifestations ont eu lieu malgré les menaces, la répression violente et les arrestations des 15 et 19 octobre, et se sont poursuivis le dimanche 26 octobre, en plein cœur de Téhéran, devant le Parlement.
Une pancarte tenue par un enfant proclamait :
« L’exécution d’une personne ne met pas fin à l’injustice ; elle engendre une nouvelle souffrance pour les enfants sans défense. »

Les prisonnières politiques du quartier 6 de la prison d’Evin, ainsi que les prisonniers politiques du quartier 7 d’Evin et ceux de Ghezel Hessar, ont exprimé leur solidarité avec cet acte de résistance
Le matin du dimanche 19 octobre 2025, six prisonniers qui avaient été transférés auparavant en isolement, en préparation de leur exécution, ont été renvoyés dans leur quartier d’origine. Une délégation de hauts responsables judiciaires et pénitentiaires s’est également rendue sur place et a promis qu’aucune exécution ne serait menée dans les mois à venir.
Ce puissant mouvement de protestation a puisé son inspiration dans la campagne nationale « Non aux exécutions du mardi », qui se poursuit sans interruption depuis 92 semaines à travers 54 prisons d’Iran. Cette campagne a uni les mères et familles des condamnés à mort aux militants abolitionnistes, faisant preuve d’un courage et d’une persévérance remarquables. Malgré les menaces, les intimidations et le harcèlement permanent du régime, ce mouvement ne cesse de croître, gagnant des dizaines de villes à travers le pays et bénéficiant d’un soutien international croissant.

Résistance et protestations des prisonnières politiques et leur retour à Evin
Les prisonnières politiques transférées du quartier des femmes de la prison d’Evin vers la prison de Qarchak durant le conflit pénitentiaire de douze jours n’ont jamais cessé leur résistance et leurs protestations, malgré les conditions effroyables, inhumaines et bien en deçà des normes les plus élémentaires.
Les 29 et 30 septembre 2025, elles ont entamé une grève de la faim pour protester contre la mort de leur codétenue Somayeh Rashidi, décédée faute de soins médicaux. En représailles, les autorités de Qarchak ont privé plusieurs prisonnières – dont Shiva Esmaeili, Marzieh Farsi, Forough Taghipour, Arghavan Fallahi, Anisha Asadollahi et Golrokh Ebrahimi – de visites familiales à trois reprises.
Dans le même temps, les prisonniers politiques du quartier 7 de la prison d’Evin ont organisé un sit-in dans la cour de promenade, en solidarité avec les prisonnières à Qarchak et pour protester contre leurs conditions. Leurs principales revendications portaient sur :
Le transfert immédiat des prisonnières politiques de Qarchak vers Evin, la libération des prisonnières malades, la poursuite des responsables de la mort de Somayeh Rashidi, et la création de cliniques médicales indépendantes dans les prisons.
Sous la double pression de ces protestations et de la mobilisation publique, tant nationale qu’internationale, le régime a finalement été contraint de transférer les prisonnières politiques de Qarchak vers Evin.

Aux premières heures du jeudi 9 octobre 2025, un groupe de prisonnières politiques, accompagné de quatre femmes condamnées pour des affaires financières, a été transféré sous haute sécurité au quartier 6 de la prison d’Evin. Le transfert s’est déroulé dans un important convoi de véhicules de sécurité et plusieurs bus, avec de multiples fouilles, en pleine nuit.
Les informations ultérieures indiquent que plus de 60 prisonnières politiques ont été déplacées vers le quartier 6. Elles ont été privées de besoins humains et d’hygiène élémentaires : à l’approche du froid automnal, elles n’avaient ni lits, ni couvertures, ni chauffage. Beaucoup ont dû dormir à même le sol en béton. L’éclairage était insuffisant, l’air étouffant, et l’accès à l’eau chaude très limité.
Malgré l’ampleur de ce transfert et la sensibilité de la situation, aucun responsable de l’Organisation pénitentiaire ou du pouvoir judiciaire n’a, à ce jour, fourni la moindre explication. Les familles rapportent que les visites et la livraison de couvertures ou de matériel de chauffage ont été interdites, et que les appels téléphoniques des prisonnières sont limités à quelques minutes par semaine.
Il convient de noter que ce retour des prisonnières politiques à Evin ne concernait que celles qui avaient été transférées à Qarchak après l’attaque contre Evin lors de la « guerre de douze jours » du 23 juin.
La prison de Qarchak continue d’héberger des milliers de détenues pour des infractions de droit commun. Par ailleurs, certaines prisonnières politiques, dont Maryam Akbari Monfared, y sont toujours maintenues, en violation du principe de séparation selon le type d’infraction.
État de santé critique de prisonnières politiques privées de soins médicaux
Un autre aspect crucial du rapport d’octobre concerne la situation médicale de plusieurs prisonnières politiques qui, malgré la gravité de leur état, se voient refuser tout accès aux soins. Le régime prive délibérément ces femmes de traitement afin de les handicaper, de les isoler ou de les tuer à petit feu par la maladie. Il s’agit là d’une forme d’exécution silencieuse au sein des prisons du régime. Voici la situation de plusieurs de ces prisonnières résilientes :

De gauche à droite : Maryam Akbari Monfared, Shiva Esmaeili, Fatemeh Ziaii et Hoda Mehreganfar
Maryam Akbari Monfared, l’une des prisonnières politiques les plus anciennes et les plus résistantes, entame sa seizième année d’emprisonnement sans un seul jour de permission. Selon des informations récentes, elle souffre depuis plusieurs mois de fortes douleurs au dos et aux genoux, d’engourdissements des jambes et de troubles de la mobilité. Malgré les recommandations de spécialistes et un rapport officiel de médecine légale exigeant des séances quotidiennes de physiothérapie, les autorités pénitentiaires refusent de la transférer vers un centre médical.
Des sources proches de sa famille ont déclaré :
« Maryam a besoin d’aide pour les tâches les plus simples, mais les autorités exigent une autorisation du juge. Deux semaines se sont écoulées depuis sa demande, sans aucune réponse. »
Les médecins ont averti qu’une poursuite de cette négligence pourrait entraîner des lésions nerveuses irréversibles et une incontinence urinaire. La médecine légale avait déjà souligné la nécessité d’une intervention chirurgicale au dos et aux genoux, mais l’absence d’infrastructures et la négligence délibérée des autorités ont gravement aggravé son état. Selon des sources internes à la prison d’Evin, elle ne dort plus la nuit tant la douleur est intense et ne peut se déplacer qu’à l’aide d’antalgiques puissants.
Hoda Mehreganfar, ingénieure en électronique âgée de 38 ans et prisonnière politique détenue à la prison d’Adelabad à Chiraz, se trouve dans un état de santé critique. Les services de sécurité continuent d’empêcher son transfert à l’hôpital, mettant sa vie en grave danger.
Selon des sources bien informées, elle souffre d’une récidive d’endométriome, comportant un risque de rupture interne et d’infection. Le médecin de la prison avait insisté sur la nécessité d’une hospitalisation immédiate, mais les autorités, invoquant des « ordres directs des services de sécurité », ont bloqué cette recommandation. Elle souffre aujourd’hui de douleurs chroniques, de forte fièvre et d’une extrême faiblesse, sans accès aux médicaments prescrits. Une source proche de sa famille rapporte :
« Hoda est détenue dans des conditions où elle ne peut ni se reposer ni s’alimenter correctement. Sa santé se détériore chaque jour. »
Shiva Esmaeili, 60 ans, prisonnière politique détenue à Evin, souffre de douleurs dorsales si intenses qu’elles affectent sa respiration et la rendent presque incapable de bouger.
Le 19 octobre 2025, après des semaines de souffrance et de négligence, les autorités ont enfin autorisé son transfert à l’hôpital. Cependant, lorsque les agents ont découvert que sa carte bancaire ne contenait plus de fonds, et sur ordre du directeur de la prison, elle a été renvoyée à Evin. Bien qu’elle ait proposé de contacter sa famille pour couvrir les frais, les autorités lui ont délibérément refusé ce droit.
Ce comportement montre comment les responsables de la prison d’Evin utilisent l’accès aux soins médicaux comme instrument de pression et de torture psychologique contre les prisonnières politiques.
Fatemeh Ziaii, 68 ans, ancienne prisonnière politique des années 1980, détenue à Evin, a passé plus de treize ans dans les prisons et centres de torture du régime. Elle souffre d’une sclérose en plaques avancée et se voit refuser les soins essentiels. Arrêtée le 6 août 2025 lors d’un raid à son domicile, tous ses appareils de communication ont été saisis. Il s’agit de sa septième arrestation en quatre décennies.
L’indignation internationale face à la vague d’exécutions en Iran
L’augmentation vertigineuse des exécutions et les violations massives des droits humains en Iran ont suscité une vague de condamnations internationales.
Dans une déclaration, Amnesty International a appelé les États membres de l’ONU à « faire pression d’urgence sur les autorités iraniennes pour mettre fin à la hausse terrifiante des exécutions ».
Le directeur adjoint régional d’Amnesty pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Hussein Baoumi, a déclaré :
« Les États membres de l’ONU doivent affronter la frénésie d’exécutions des autorités iraniennes avec toute l’urgence qu’elle requiert. »
De son côté, António Guterres, secrétaire général des Nations unies, s’est dit profondément préoccupé par la situation des droits humains en Iran, appelant à l’arrêt immédiat des exécutions, à la libération des prisonniers politiques et à la fin de la torture et des traitements inhumains dans les prisons.
Son rapport, publié en octobre 2025, met en lumière la multiplication des exécutions, y compris celles de prisonniers politiques, de personnes accusées de délits liés à la drogue ou de « corruption sur terre », et souligne le caractère systématique des violations des droits humains dans le pays.
Selon ce rapport, de nombreuses exécutions reposent sur des aveux arrachés sous la torture, dans des procès dépourvus de garanties légales ou d’accès à un avocat. António Guterres a rappelé que les exécutions publiques, notamment de manifestants, constituent des actes de torture et de traitement inhumain, en violation flagrante des engagements internationaux de l’Iran.
Les actes de torture et les traitements dégradants dans les prisons et centres de détention se poursuivent : recours à l’isolement prolongé, restrictions sévères des contacts avec les familles et les avocats, et confessions forcées sous la contrainte. Le secrétaire général de l’ONU, s’appuyant sur les conclusions de la mission d’enquête onusienne, a qualifié ces pratiques de violations claires de la Convention contre la torture, exhortant l’Iran à y adhérer.
Appel urgent à une action internationale
Le meurtre délibéré de prisonniers politiques malades, méthode bien connue du régime clérical, constitue un crime contre l’humanité.
La Commission des Femmes du CNRI appelle à une intervention immédiate du Conseil des droits de l’homme, du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, du Rapporteur spécial de l’ONU, et de toutes les instances concernées pour obtenir la libération immédiate des prisonnières politiques malades.
Elle réaffirme la nécessité urgente de dépêcher une mission internationale d’enquête afin d’inspecter les prisons iraniennes et de rencontrer les prisonniers, en particulier les femmes prisonnières politiques, victimes de privation de soins, de torture et d’exécutions silencieuses.